Posts tagged "ideas":
Altruisme efficace et milliardaires philanthropes
J'écoutais un épisode du podcast Making sense dans lequel Sam Harris avait un échange avec William MacAskill sur le sujet de l'altruisme efficace, quand j'ai été incommodé par cette idée : il serait une bonne chose que d'être un milliardaire philanthrope. Est-ce une détestation primaire des riches, ou bien quelque chose de plus complexe?
L'altruisme efficace
Commençons par poser le cadre de la discussion : l'altruisme efficace. Il s'agit d'une approche de la philanthropie visant à maximiser l'efficacité des dons :
Traditionnellement, les évaluations d'organisations caritatives se concentrent sur la minimisation des coûts administratifs en proportion du coût d'un programme. Les altruistes efficaces rejettent cette méthode de mesure, qu'ils considèrent simpliste et erronée. Les altruistes efficaces préfèrent mesurer les résultats obtenus par unité de ressource investie, quelle que soit la part de coûts administratifs.
Il s'agit d'une approche très pragmatique conséquentialiste qui essaye de s'affranchir de toute émotivité liée à la proximité sociale ou géographique des bénéficiaires des dons. Par exemple, il vaudrait mieux donner à des ONG qui s'occupent de lutter contre le paludisme en Afrique que de donner aux Restos du cœur.
L'altruisme devient donc une science et un business avec tout un ensemble d'entités (GiveWell, Future of Humanity Institute, Giving What We Can) qui s'occupent d'établir des listes et des classements des ONG les plus efficaces.
On peut aussi «donner sa carrière», ce qui permet de donner un peu de sens à certains bullshit jobs.
Ce qui pourrait être gênant dans l'altruisme efficace
D'après la présentation qui en est faite dans Wikipédia, «les altruistes efficaces tentent d'identifier l'importance de différentes causes, selon leur potentiel à atteindre des objectifs généraux tels que l'augmentation du bien-être des individus.»
Encore faut-il définir le bien-être des individus. Dans l'altruisme efficace, on parle souvent de sauver des vies, mais il n'est pas sûr que tout individu sauvé du paludisme ou de la malnutrition puisse jouir de bien-être. Si on pousse la logique utilitariste au bout, on pourrait imaginer que la somme totale de bien-être dans le monde augmente quand il n'y a pas d'individu qui souffre et donc, une façon d'éliminer la souffrance est d'éliminer les individus qui souffrent. Heureusement, ce raisonnement digne d'une intelligence artificielle dystopique est exclue par les altruistes efficaces (et de toute façon, la première loi de la robotique nous couvre sur ça aussi).
Mais sans tomber dans ce niveau de cynisme abjecte, on peut légitimement se poser la question de la hiérarchie du bien. Il y a des domaines où la «quantité de bien» est difficile à mesurer et cela n'est pas compatible avec les outils quantitatifs de l'AE :
Les essais contrôlés randomisés occupaient originellement une grande place dans l'évaluation des actions par les altruistes efficaces. Pascal-Emmanuel Gobry, membre du think tank conservateur Ethics and Public Policy Center, met en garde sur l'effet Réverbère : certains domaines, tels que la recherche médicale ou l'aide à la réforme de la gouvernance des pays en développement, ont un rapport coût-efficacité difficile à mesurer par des essais contrôlés. Ils risquent donc d'être sous-évalués par le mouvement de l'altruisme efficace faute de données, indépendamment de leur efficacité réelle. Jennifer Rubenstein, professeur spécialisée en théorie politique, émet elle aussi l'hypothèse d'un altruisme efficace pouvant être biaisé en défaveur des causes difficiles à mesurer. La mesurabilité du bonheur est aussi débattue.
Toujours est-il que les altruistes efficaces considèrent actuellement comme prioritaires l'extrême pauvreté, la souffrance des animaux dans les élevages industriels, et la prise en compte des risques existentiels.
Par contre, un des points appréciables (mais pas apprécié par tout le monde 1) est la non relativité morale : toute vie, qu'elle soit celle d'un proche ou celle d'un inconnu vivant à l'autre bout de la planète, a la même valeur. Le raisonnement va au delà de la dimension géographique et s'étend à la dimension temporelle : les générations futures auraient une valeur morale égale à celle des personnes vivantes dans le présent, ce qui demande de réduire les risques existentiels à l'humanité.
Là, on glisse sur des terrains un peu new age. Si on ne peut, en effet, justifier l'expoliation des ressources physiques et biologiques, on peut se dire que le simple fait de produire des générations futures est en soi un risque existentiel. Mais pas seulement. Cela constitue un acte égoïste qui va faire exister des personnes qui seront exposées à des souffrances. Les altruistes efficaces, s'ils étaient cohérents, devraient s'abstenir de procréer (et peut-être que le reste de l'humanité aussi, mais je m'égare).
La dernière dimension sur laquelle le non relativisme moral de l'AE s'applique est celle des espèces vivantes :
D'autres pensent que, indépendamment de l'espèce de chaque individu, des intérêts égaux devraient mener à une égale considération morale, et travaillent donc à prévenir les souffrances animales, telles que celles causées par l'élevage industriel.
Le dernier point qui fait débat, est celui de l'industrie créée autour de l'AE (voir ci-dessus). En effet, pour être vraiment efficace, l'altruiste moderne a besoin de savoir où placer son argent (et éventuellement son temps si on est jeune et fraîchement diplômé d'une école de commerce de bonne réputation). Une fois que l'impératif moral nous pousse à agir, y penser tout le temps est pénible et angoissant. On peut donc sous-traiter.
Le problème de la philanthropie
Revenons à la question de départ. L'altruisme pouvant être efficace, l'existence de riches philanthropes qui y adhèrent serait une bonne chose.
Qui est le philanthrope?
D'après le Littré, un philanthrope est
celui dont le coeur est porté à aimer les hommes, particulièrement celui qui s'occupe des moyens d'améliorer le sort de ses semblables.
Wikipédia nous dit que le mot philanthropie
[…] désigne une philosophie ou doctrine de vie d'inspiration humaniste émanant d'une catégorie sociale de personnes s'estimant matériellement nanties et mettant la cohésion de l'humanité au premier plan de leurs priorités. Née à la fin du siècle des Lumières, à une époque par conséquent marquée par la déchristianisation et la montée en puissance des États-nations, cette philosophie tient lieu de substitut à la charité chrétienne et préfigure en partie ce que seront plus tard les politiques publiques d'aide sociale, du moins dans des pays comme la France, marqués par la culture laïque (aide assurée directement par l'État ou par le biais de structures déclarées d'utilité publique). Aux États-Unis, nation où la religion chrétienne interfère en revanche toujours beaucoup avec la politique, les pratiques de philanthropie sont particulièrement vivaces.
On voit que cette entrée Wikipédia a besoin d'être actualisée en ce qui concerne la France, mais il est intéressant de voir les liens avec la charité chrétienne. On comprend aussi que n'est pas philanthrope qui veut : seulement les matériellement nantis peuvent l'être. Ils ont donc du mérite, car rien ne les oblige à partager leurs richesses. Si certains sont nantis par le droit divin (l'héritage de la fortune de leurs ancêtres) d'autres le sont devenus par leur travail. En fait, si on applique un peu de transitivité, même la richesse d'un héritier est le fruit du travail (de l'ancêtre) dont l'héritier n'est que l'administrateur. Donc, sans perte de généralité, on peut dire que la position de nanti a été gagnée par le mérite et le travail. En conséquence, le philanthrope a du mérite car c'est un self-made man, même quand il ajoute le prénom de son épouse au sien pour nommer sa fondation.
Le mythe du self-made man
Il y a tout de même un petit problème avec cette notion de self-made man : c'est un mythe. On sait, par exemple, que le lieu de naissance détermine en grande mesure le niveau de revenus. On peut voir ici une étude concernant la Grande Bretagne. Si les disparités entre Londres et Cardiff ne sont pas énormes, on peut imaginer qu'elles sont beaucoup plus importantes entre Seattle et Kampala, par exemple. Et si on y ajoute le capital social, le capital tout court obtenu par héritage, etc. on peut dire que le mérite des riches philanthropes est un peu moins important que ce que l'on a tendance à penser. Mais, quoi qu'il en soit, une fois devenus riches (par leurs mérites ou par leurs privilèges), on ne peut pas leur enlever le mérite de donner une partie de leurs richesses. Ou peut-on?
Nous mettrons de côté le cynisme de ceux qui doutent des motivations des philanthropes … mais en fait, non, car Wikipédia nous dit :
Selon les contextes, la philanthropie est portée par un idéal authentiquement altruiste ou au contraire par le souci de s'insérer dans la bien-pensance de la classe dirigeante, la bourgeoisie, et celui d'en retirer un bénéfice indirect, en termes de reconnaissance sociale. Le mécénat des entreprises est généralement désigné sous le terme de Responsabilité sociétale (ou sociale) et est en partie encadré par la norme ISO 26000.
Mais, essayons tout de même de faire abstraction des motivations (et encore plus des normes ISO) et mettons-nous à la place de ces personnes qui donnent une partie de leur fortune, qui est bien la leur. Elle leur appartient. Même si certains le contestent :
« Le néo-libéralisme a mis fin à l'idée que l'État pouvait être un recours de la société contre les effets désastreux du capitalisme […]. La propriété publique est alors apparue non pas comme une protection du commun, mais comme une forme «collective» de propriété privée réservée à la classe dominante, laquelle pouvait en disposer à sa guise et spolier la population selon ses désirs et ses intérêts. »
Sans vouloir pousser à la révolution (je tiens tout de même à mes petits privilèges de bourgeois), il est tout de même important de ne pas oublier que les capitalistes s'approprient les biens communs. Et donc, entre privilège de départ et usurpation par la suite, la propriété du philanthrope perd un peu de légitimité.
Mais, même si on notre raisonnement est le bon, il n'est pas performatif et le philanthrope est toujours propriétaire de sa fortune.
Mais pourquoi donnerait-il sa fortune aux autres?
Si on remonte suffisamment dans la chaîne de l'héritage (des individus ou des états2) on arrive toujours à un moment où quelqu'un est devenu riche en s'appropriant de façon arbitraire une ressource. Cela a pu être parce que cette ressource n'appartenait à personne, ou bien parce que la force a permis de trancher une dispute.
Pour une analyse sérieuse sur ce sujet, on pourra lire La Part commune - Critique de la propriété privée de Pierre Crétois dont les grandes lignes sont résumées dans cet entretien. On y découvre que la notion de propriété a quatre attributs supposés : son caractère naturel, qu'elle serait le fruit du travail, donc qu'elle sanctionnerait un mérite et l'impossibilité d'interférer dans cette propriété.
Voici la racine de la justification de l'appropriation des choses par le travail :
[…] Locke se demande comment faire pour transformer quelque chose qui a été originellement donné par Dieu à tous en un quelque chose qui est à moi. Le tout, sans solliciter l'avis des autres et de manière moralement irréprochable. Locke estime que puisque l'on est propriétaire de soi-même, il suffit que je mette dans cette chose mon travail, autrement dit quelque chose qui est naturellement à moi pour qu'elle m'appartienne en propre. Dès lors, nul ne peut vouloir se saisir de ce que j'ai travaillé sans se saisir de quelque chose qui est naturellement à moi. C'est le cœur de cette justification morale de l'appropriation privative par le travail.
Il faut donc avoir travaillé pour pouvoir revendiquer la propriété. Encore un argument qui délégitime la fortune de la plupart de nantis. Et nous avons déjà parlé des rentiers dans un autre article.
Mais le plus important, est de comprendre que la propriété n'est pas un droit fondamental, car
[…] un droit fondamental est censé se suffire à lui-même. Or, le droit de propriété a pour justification d'être un instrument au service d'autres droits : la subsistance, l'indépendance, la dignité. Pour cette raison, c'est un droit instrumental et donc secondaire.
Et donc, la fortune du self-made man (de premier ordre ou par transitivité), une fois amputée du pécule nécessaire à la subsistance, l'indépendance et la dignité, devient moins légitime.
Philanthropie et démocratie
Que l'on soit d'accord ou non sur le mérite du philanthrope à avoir amassé sa fortune et a être prêt à la redistribuer et sur la légitimité de toute l'opération, il reste encore un problème avec le modus operandi des philanthropes. Leur fortune leur permet de décider ce qui est bon pour l'humanité.
En effet, le philanthrope choisit où il met son argent. Dès lors, l'utilisation de ces ressources échappe à tout débat démocratique : les ressources sont allouées en fonction des préférences du philanthrope et éventuellement de ses conseillers. Étant donnés les rapports de force qui interviennent, on est plutôt face à un système monarchique et sa cour, et on peut imaginer le peu de poids que des conseillers éclairés peuvent avoir.
Si l'idée de remplacer les monarchies absolutistes pour instaurer des démocraties3 fait partie de la pensée mainstream aujourd'hui, on voit que l'on continue à accepter l'existence de personnes qui, pour le simple fait d'être riches, ont beaucoup plus de poids sur des décisions qui impactent des millions de personnes. C'est un échec qui a des conséquences importantes. Dans l'article Wikipédia sur l'altruisme efficace on peut lire :
L'économiste Daron Acemoglu y affirme que « quand des services importants que l'on attend d'un État sont pris en charge par d'autres entités, il peut devenir plus difficile de construire une relation de confiance entre les citoyens et l'État. »
Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème politique
Un point qui n'est pas abordé habituellement dans les critiques de l'AE est celui de la faillite des systèmes politiques de gouvernement en place. En effet, si on a besoin de passer par des ONG (où le N veut dire non et le G signifie gouvernemental) est parce que les pouvoirs publics ne veulent-peuvent-savent résoudre les problèmes. On pourrait se dire que, en effet, les pays qui souffrent de paludisme ou de malnutrition ont des gouvernements impuissants (et on évitera de se poser la question du pourquoi de cette situation), mais que cela n'est pas le cas dans les pays dits développés. Mauvaise réponse et voici un contre-exemple4 : San Francisco, endroit placé dans un pays économiquement puissant, où la concentration de hauts et très hauts salaires est sans commune mesure, n'arrive pas à résoudre le problème des sans abri. On pourra rétorquer que les USA ne sont pas l'exemple de la répartition équitable des richesses, mais que dans notre bonne vieille Europe, et qui plus est, dans le pays des droits de l'homme5 et le la révolution6 cela n'arrive pas. En fait, si. Parce que l'argent magique n'existe que pour sauver les banques, les pétroliers et les avionneurs, en face d'un virus incontrôlable, on a demandé à des couturières de travailler gratuitement et les hôpitaux publics ont été obligés de faire la manche :
Des renforts sont nécessaires, dans l'immédiat pour le soutien aux équipes en première ligne et comme pour le lancement des projets de recherche mais aussi dans les semaines à venir, pour continuer à soutenir toutes les initiatives qui auront émergé et les besoins qui resteront non couverts.
Pour cela, nous avons besoin de votre soutien, exceptionnel et immédiat. […] Lancée en 2016, la Fondation de l'AP-HP pour la Recherche mobilise de nouvelles ressources en soutien aux projets menés par les équipes de l'AP-HP et leurs partenaires (Universités, INSERM, Institut Pasteur, etc.). En quatre ans, plus de 2000 donateurs lui ont fait confiance, mobilisant 18 millions € en soutien à plus de 200 équipes, dans tous les domaines (maladie d'Alzheimer, épilepsie, cancer, diabète, maladies rares, etc.).
Si la force de travail existe et l'argent aussi (puisqu'on est capable de faire des dons), on se demande quel est le rôle des pouvoirs politiques si ce n'est pas celui d'organiser la redistribution des ressources (temps et argent) de la façon la plus efficace.
Pour ceux qui croient au mythe de la nécessité des états, il n'y a qu'une façon d'assurer le contrôle démocratique : l'impôt. Malheureusement, les états-nation dont les gouvernements sont élus en simili-démocratie démissionnent et délèguent la gestion de la res publica au bon vouloir d'acteurs économiques sans légitimité démocratique.
Et, comble des démocraties modernes, non seulement on renonce à taxer plus fortement le capital, mais on fait des réductions d'impôts pour ceux qui font des dons, ce qui leur permet d'orienter les dons vers des opérations qui peuvent les enrichir7.
Conclusion
Si on reste à la surface du phénomène, l'altruisme efficace semble une très bonne façon d'utiliser son argent et son temps pour augmenter la quantité de bien-être dans le monde. Si on s'y penche un peu, on peut se poser des questions sur la façon de mesurer ce bien-être et aussi sur l'industrie créée autour de ce mouvement. Mais le point crucial est celui d'accepter que certains puissent décider quelles sont les causes à soutenir et la façon de le faire et ceci cautionné par des pouvoirs politiques qui démissionnaires.
Footnotes:
Nous avons évolué vers le besoin de protéger la tribu d'abord
Nous parlerons de colonialisme une prochaine fois.
même si certaines ont besoin de garder cette figure paternaliste par le biais d'un roi, même élu tous les 5 ou 7 ans
Petite précision pour ceux qui étaient confinés le jour du cours d'intro à l'histoire des révolutions scientifiques : un contre-exemple suffit à falsifier une théorie.
blanc, hétérosexuel et riche
bourgeoise
Par exemple, un éditeur de logiciels, peut faire des dons en nature à une ONG qui travaille dans l'éducation au numérique. Les bénéficiaires des actions de l'ONG seront formés aux outils du-dit éditeur de logiciel et seront donc clients potentiels.
Nous voulons tous être des rentiers
D'après le Littré, un rentier est un bourgeois qui vit de son revenu, sans négoce, ni industrie. Wikipédia, développe un peu plus et dans son entrée pour rente dit :
«Une rente est, pour un particulier, une somme fixée à l'avance reçue périodiquement (par exemple chaque mois ou chaque année), pour une durée fixée d'avance (rente certaine) ou, éventuellement, pour le reste de sa vie (rente viagère), provenant du patrimoine de ce particulier. Une rente est également définie de façon plus générale comme le revenu provenant d'un patrimoine.»
Malheureusement, dans l'entrée Wikipédia, il n'y a pas de mode d'emploi pour arriver à être un rentier, ce qui est un peu frustrant, il faut l'avouer. Il me semble que, en fonction des modèles auxquels on a été exposé en grandissant, chacun cherche à être rentier à sa façon : un poste de fonctionnaire (peu importe l'administration) si on n'est pas trop attiré par le bling-bling, banquier si on a des tendances sociopathes, politicien professionnel si on a du mal à maîtriser sa libido, ou célébrité dans les cas où le QI ne permet pas autre chose.
Une des recettes miracle qui apparaissent en cherchant un peu sur le web est celle de la communauté FIRE (pour Financial Independence Retire Early), dont l'objectif est
«d'économiser un montant à partir duquel les intérêts générés par les placements fournissent assez d'argent pour supporter les frais de la vie courante.»
La façon d'arriver à économiser suffisamment vite – et que les intérêts générés suffisent jusqu'à la fin de ses jours – est simple : adopter un mode de vie frugal et donc réduire les coûts courants à l'essentiel. À première vue, cela semble intéressant, d'autant plus que la frugalité devrait permettre de réduire son impact écologique. C'est donc du green win-win. On est par conséquent tenté de regarder un peu plus en détail et chercher le piège dans l'affaire.
S'il y a des critiques concernant la viabilité de l'approche (le risque des investissements, la façon de calculer le revenu à long terme, car on parle tout de même de gens qui veulent prendre la retraite à 35 ans), il y en a très peu sur la viabilité du concept à l'échelle d'une société. Si tout le monde adoptait le FIRE, il y aurait peu d'occasions d'investir dans des affaires capitalistes jouteuses. D'un autre côté, on pourrait imaginer que si tout le monde devenait frugal (c'est à dire, plus de banquier sociopathe ou de célébrité à lunettes de soleil à monture dorée), il suffirait que les jeunes travaillent. Ou bien que tout le monde travaille juste un peu.
Travailler juste un peu et avoir du temps pour les loisirs? Ça peut paraître carrément disruptif, mais d'après le livre de Jean-Paul Demoule Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'Histoire, c'était un peu le cas déjà dans le paléolithique :
«[…] les chasseurs-cueilleurs qui ont pu être observés avant leur anéantissement ne consacraient en moyenne que trois heures par jour à l'acquisition de leur nourriture, soit vingt et une heures par semaine, le reste du temps étant voué aux loisirs.»
Et il ajoute, qu'en termes de richesse relative, nous ne sommes pas avantagés :
«Si l'on considère que nous travaillons toute la journée, essentiellement pour survivre, les loisirs n'occupant qu'une place restreinte et la fameuse semaine de 35 heures restant un acquis fragile et réservé à peu de pays, il est indéniable que l'abondance relative des chasseurs-cueilleurs était bien supérieure à la nôtre, nous qui vivons des produits de l'agriculture. C'est là plus qu'un aimable paradoxe.»
Dans un monde où le bang for the buck semble être le critère ultime pour juger de l'utilité de toute activité, on peut dire qu'on a besoin de réformes et de modernisation dans cette affaire.
Sur le même sujet, Yuval Noah Harari, dans Sapiens; une brève histoire de l'humanité, parle carrément d'escroquerie à propos de la révolution agricole, quand il explique que :
- le fermier moyen travaillait plus dur que le chasseur-cueilleur moyen, mais se nourrissait moins bien,
- le travail agricole fit apparaître des maux de dos,
- dans les sociétés agricoles, il y avait moins d'espace pour la liberté individuelle, car en cas de conflit, partir signifiait abandonner ses moyens de subsistance, ce qui n'était pas les cas pour les fourrageurs.
En synthèse, la révolution agricole bénéficia l'espèce, mais pas les individus : les champs de blé, permettent de nourrir plus de monde que les plantes sauvages, mais ces individus ont des conditions de vie moins bonnes. Cela marche à long terme, parce que c'est une réussite pour l'espèce (plus de copies d'ADN), même si les individus sont moins heureux.
Mais le modèle du chasseur-cueilleur rentier n'est plus applicable à notre époque, car nous sommes beaucoup trop nombreux. Il faut donc qu'au moins certains produisent. Demoule, parle même de capitalisme extractionniste qui a perduré jusqu'à nos jours : la pêche en mer et l'extraction de matières premières relèvent d'une logique de prédation identique à celle des chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Ce point de vue est en phase avec celui de Harari, qui nous explique que :
«Homo sapiens provoqua l'extinction de près de la moitié des grands animaux de la planète, bien avant que l'homme n'invente la roue, l'écriture ou les outils de fer.»
La 2ème vague d'extinction eut lieu lors de la révolution agricole (la 1ère, lors de la révolution cognitive). La 3ème a lieu maintenant. Les 2 premières extinctions épargnèrent les animaux marins, ce qui ne sera pas le cas actuellement. Mais on s'égare.
Nos ancêtres n'avaient pas les outils de l'économie capitaliste et ne pouvaient donc pas faire fructifier le capital et en faire bénéficier même les sans dents.
Malheureusement, pour chaque théorie économique, il y a toujours des alternatives qui viennent la contredire. Par exemple, Martine Orange dans Médiapart, cite Michel Husson, qui explique que les rendements du capital ne peuvent être élevés que s'il y a peu de détenteurs :
« L'extension de leurs privilèges à d'autres couches sociales impliquerait leur «évaporation». » […] « La valorisation fictive d'actifs financiers, déconnectée de l'économie réelle, ne peut que s'effondrer. »
En fait, il semblerait que le régime actuel pourrait être appelé capitalisme de rente protégé :
«Tout en revendiquant la prise de risques, à des rendements du capital exorbitants et des rémunérations hors norme, le monde financier et les grands groupes ne cessent de réclamer des garanties, des protections, des sécurités. Ils ont installé un capitalisme de rente protégé, normé, contractualisé, qui leur permet de poursuivre les États, mais interdit l'inverse.»
Et donc, il y a bien des rentiers, mais ce sont toujours les mêmes. Et si, au lieu de protéger seulement ce petit groupe sélect nous nous protégions tous ensemble?
Les progrès de l'automatisation (mécanique ou cognitive) devrait permettre de ne pas travailler. Peut-être pas tout de suite, car comme l'explique David Graeber dans Bullshit Jobs, pour l'instant, une partie de l'automatisation du travail fait émerger pas mal d'aliénation dans le travail, où beaucoup de tâches cognitives sont remplacées par des tâches de mise en forme de données pour qu'elles puissent être consommées par les machines :
«Much of the bullshitization of real jobs, I would say, and much of the reason for the expansion of the bullshit sector more generally, is a direct result of the desire to quantify the unquantifiable. To put it bluntly, automation makes certain tasks more efficient, but at the same time, it makes other tasks less efficient. This is because it requires enormous amounts of human labor to render the processes, tasks, and outcomes that surround anything of caring value into a form that computers can even recognize.»
Mais les progrès dans les techniques d'analyse de données permettront de s'affranchir même de ces tâches. Et c'est à ce moment là, que toute activité productive pourra être réalisée par des machines et le travail salarié n'aura plus lieu d'être. Cela permettrait à chacun de décider comment il veut utiliser son temps, son énergie et ses compétences pour rendre service à la société.
Oui, moi aussi j'ai la larme à l'oeil, mais il faut éviter qu'elle nous trouble la vue et nous empêche de voir qu'il nous faudra des sous pour payer nourriture, vêtements et autres biens matériels. Il faut bien – enfin, certains insistent, en tout cas – qu'il y ait un système (les prix) qui limite les excès de consommation de ressources limitées.
Certains capitalistes ont compris la tendance et sont favorables à la mise en place d'un revenu de base :
«Le revenu de base, encore appelé revenu universel ou allocation universelle, est une somme d'argent versée par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans conditions de ressources ni obligation ou absence de travail. L'âge est parfois un critère discriminatif. Ce mode de fonctionnement économique est appliqué dans quelques pays ou à titre expérimental dans certaines zones.»
Il ne faut pas le confondre avec un revenu minimum qui, lui, existe déjà en France, par exemple :
«Le revenu minimum s'appelle Revenu de solidarité active (RSA). Cette allocation a été mise en place le 1er juin 2009, au terme d'une expérimentation dans 34 départements. Cette prestation garantit à ses bénéficiaires, qu'ils soient ou non capables de travailler, un revenu minimum équivalent à de 33 % à 36 % du SMIC.»
À ne pas confondre non plus avec salaire minimum qui, lui, suppose une activité salariée:
«Le salaire minimum, ou salaire minimal, est la rémunération minimale qu'un employeur peut légalement accorder à un employé pour un travail.»
Tous ces dispositifs ont comme objectif d'aider à consommer et de perpétuer le status quo. Encore un autre, qui a une longue histoire, le capital universel, fait pour faire croire qu'on peut tous être des petits capitalistes :
«L'idée du capital universel, encore appelé, capital de départ pour les jeunes ou dotation en capital pour les jeunes, est historiquement celle d'un capital versé à un âge donné, à chacun des jeunes membres d'une communauté pour l'aider à se lancer dans la vie active (ou productive).
Au XXIe siècle, le capital de départ, encore appelé capital universel, capital de base ou capital pour tous, se définirait comme une somme d'argent attribuée par une entité politique à chacun de ses jeunes membres à un âge donné pour l'aider à démarrer dans la vie. C'est, dans une certaine mesure, la transposition à l'échelle de la société de la dot que, dans de nombreuses cultures, les jeunes époux reçoivent de leurs familles à l'occasion du mariage.»
Pour ceux qui seraient frustrés de ne voir que des idées de droite pour faire participer tout le monde à la machine capitaliste, il suffit de changer capital par salaire et le tour est joué. C'est la proposition de Bernard Friot appelée salaire à vie :
«Le "salaire à vie" constitue un mode d'organisation socio-économique principalement théorisé par Bernard Friot qui consiste, en se basant sur la socialisation de la richesse produite, à verser un salaire à vie à tous les citoyens. Ce salaire universel, dont le montant serait attaché à la qualification personnelle et non plus au poste de travail occupé, a été pensé pour reconnaître le statut politique de "producteur de valeur" à l'ensemble des membres d'une communauté. Il aurait pour conséquence mécanique l'abolition du marché du travail, et donc du chômage, en reconnaissant le travail effectué en dehors du cadre d'un emploi.»
Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une nuance sémantique par rapport à l'idée de revenu de base. Dans celui-ci on garde le business as usual et on donne un pécule à tout le monde pour que même (surtout?) les pauvres avec un emploi précaire continuent à faire tourner la machine du profit capitaliste. Comme le rappellent Fabien Escalona et Romaric Godin, ce type de dispositif peut pousser au consumérisme et être une arme potentielle contre la protection sociale.
Une des critiques principales de ces dispositifs est la remise en cause de la «valeur travail» et son rôle fédérateur dans la société. Selon cette croyance, le travail permet d'organiser le vivre ensemble en assignant une place bien définie à chaque individu qui déterminera son statut et donc le niveau de reconnaissance reçue. Où comme le disait Buckminster Fuller, avoir un job nous donne le droit d'exister :
«We keep inventing jobs because of this false idea that everyone has to be employed at some sort of drudgery because, according to Malthusian Darwinian theory, he must justify his right to exist.»
Ceci ne suppose pas un problème dans un système capitaliste, car celui-ci ne se préoccupe pas de l'utilité de ce qui est produit, seule la possibilité d'en tirer un profit compte :
«Un bien très utile pourra ne pas être produit si l'on ne peut pas en tirer de profit (il suffit de penser aux médicaments qui manquent dans les pays pauvres). Inversement, la publicité et la société de consommation créent tout un tas de besoins et de marchandises d'aucune utilité si ce n'est celle de rémunérer du capital.»
L'utilité du travail ne serait donc pas une bonne motivation? Sa rétribution ne serait pas corrélée à l'utilité? Les profits n'iraient pas à ceux qui produisent, mais à ceux qui «profitent»? En fait, selon Graeber, les travailleurs deviennent de plus et plus productifs sans que les profits ne leur soient destinés. Ces profits servent plutôt à financer des postes inutiles qui seront mieux payés que les vrais travailleurs. Le tout soutenu par une idéologie du management :
«Managerialism has become the pretext for creating a new covert form of feudalism, where wealth and position are allocated not on economic but political grounds—or rather, where every day it's more difficult to tell the difference between what can be considered "economic" and what is "political."»
Essayons de prendre un peu de recul pour distinguer plusieurs notions : emploi salarié, activité productive, activité créatrice, etc. Demoule nous permet d'y voir plus clair :
«La philosophe Hannah Arendt a distingué le travail, imposé pour vivre, de l'œuvre, véritablement créatrice ; de même qu'elle a distingué le temps vide, où l'on ne fait rien d'autre que récupérer sa force de travail, du temps libre, que l'on peut consacrer à son épanouissement personnel. Comme on sait, le mot "travail" vient du latin tripalium, qui désignait un instrument de torture destiné aux esclaves. D'autres civilisations que la nôtre ont beaucoup moins magnifié le travail : pour le bouddhisme , c'est l'accomplissement de soi par la méditation et le détachement qui doit primer. L'écrivain révolutionnaire Paul Lafargue dénonça dans son livre "Le Droit à la paresse" (1880) ce qu'il considérait comme une "folie" : "L'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture" - ce qui le fit d'ailleurs [être] regardé avec une certaine méfiance par le mouvement ouvrier de l'époque.»
Pour revenir aux temps actuels, les crises climatique et de la biodiversité devraient être suffisantes pour nous faire prendre conscience que le fait d'occuper les gens à des tâches productives – et donc polluantes et consommatrices de ressources – sans vraie utilité sociale n'est pas tenable. D'un autre côté, indépendamment de cela, la technologie nous permet d'automatiser la plupart des tâches qui nous occupent, et non pas seulement les tâches mécaniques, mais aussi le travail de journalistes, avocats, médecins, ingénieurs, etc. Et cette fois-ci, la destruction créatrice risque de ne pas avoir lieu. D'après certains, on serait face à un techno-féodalisme où la rente de l'intangible, la monopolisation intellectuelle, feraient que la position dominante de quelques acteurs du numérique ne peut pas être modifiée par la magie des marchés.
Il y a tout de même un peu d'espoir. Ces géants du numérique sont principalement financés par la publicité (80% pour G et 98% pour F). On commence à prendre conscience que cette publicité ne marche pas. Certains prédisent l'éclatement de cette bulle pour les prochaines années. La fiabilité de ces prédictions est bien entendu à prendre avec des pincettes, car elles (les prédictions, pas les pincettes) sont faites avec les mêmes outils qui ont servi à ne pas voir la plupart des crises économiques précédentes. D'un autre côté, ce n'est pas parce que l'on sait que quelque chose n'est pas rentable ou efficace qu'on arrête de l'utiliser (cf. la théorie des Bullshit jobs de Graeber).
Optimisme limité, donc, mais avec la conscience que les 2 options proposées, à savoir : 1) tous rentiers de l'économie numérique 2) tous techno-serfs du féodalisme numérique, découlent de la servitude volontaire.
Soyons donc résolus de ne plus servir.
Le management dans le cambouis
Quelqu'un me faisait remarquer l'autre jour que les propos de Crawford sur les "métiers fantomatiques" étaient méprisants et que de la défense des métiers manuels il en fait une attaque contre les tâches de gestion ou de management.
Je n'ai pas ressenti cela en lisant le livre de Crawford et il s'agit peut-être tout simplement d'un manque de contexte dans mes 2 billets sur le sujet. Quand Crawford fait la critique du travail qui n'a pas de production tangible, il se base principalement sur son expérience de rédacteur de résumés d'articles scientifiques, tâche qu'il a vécu comme quelque chose qui n'avait aucun sens ni aucune vraie utilité. Il est donc très négatif sur ce type d'activité, mais j'ai compris sa critique comme une explication du non sens que l'individu peut vivre (il en est donc victime) et non comme un mépris de l'individu qui réalise la tâche.
Je ne pense pas que la critique de Crawford doive être interprétée comme une façon facile de taper sur les chefs qui profitent du travail de leurs subordonnés. En tout cas, ce serait vraiment naïf de penser que tous les postes dans les entreprises qui ne sont pas liés directement à la production sont "fantomatiques". Il y a souvent besoin de postes de management, non pas pour des questions d'autorité ou de prise de décision seulement, mais surtout pour que quelqu'un puisse avoir une vue d'ensemble d'activités qui impliquent beaucoup de contributions et parties différentes. Il est souvent crucial de détecter des possibilités de collaboration, détecter des doublons inutiles, etc. Ou pour utiliser la LQR, développer des synergies.
Ce n'est peut-être pas nécessaire dans un atelier de réparation de motos où travaillent 4 ou 5 personnes, mais pour concevoir une des motos qui y sont réparées, il faut bien quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, chacune spécialiste de technologies très différentes. Sans des individus qui sont capables de tisser des liens entre ces différentes activités, il est impossible d'arriver à des résultats efficacement.
Je pense que le livre de Crawford a 2 messages principaux :
- des individus peuvent avoir besoin de mesurer de façon objective l'utilité de leur travail;
- le travail technique ou manuel a une valeur aussi grande que le travail purement cognitif ou de gestion qui a tendance à être vu comme la seule voie de réussite professionnelle.
Métiers fantomatiques et jugement infaillible de la réalité
J'ai l'impression que le livre de Crawford1 à propos duquel j'ai commencé à écrire ici, va me donner beaucoup de matière pour ce blog.
Dans son ouvrage, Crawford "plaide plaide pour un idéal qui s'enracine dans la nuit des temps mais ne trouve plus guère d'écho aujourd'hui : le savoir-faire manuel et le rapport qu'il crée avec le monde matériel et les objets de l'art." Il est conscient que son point de vue est difficile à défendre dans notre société de la connaissance :
Ce type de savoir-faire est désormais rarement convoqué dans nos activités quotidiennes de travailleurs et de consommateurs, et quiconque se risquerait à suggérer qu'il vaut la peine d'être cultivé se verrait confronté aux sarcasmes du plus endurci des réalistes : l'économiste professionnel. Ce dernier ne manquera pas, en effet, de souligner les "coûts d'opportunité" de perdre son temps à fabriquer ce qui peut être acheté dans le commerce. Pour sa part, l'enseignant réaliste vous expliquera qu'il est irresponsable de préparer les jeunes aux professions artisanales et manuelles, qui incarnent désormais un stade révolu de l'activité économique. On peut toutefois se demander si ces considérations sont aussi réalistes qu'elles le prétendent, et si elles ne sont pas au contraire le produit d'une certaine forme d'irréalisme qui oriente systématiquement les jeunes vers les métiers les plus fantomatiques.
Par "métier fantomatique", Crawford entend les activités non directement productives et dont le résultat n'est pas tangible ou mesurable.
Qu'est-ce qu'un "bon" travail, qu'est-ce qu'un travail susceptible de nous apporter à la fois sécurité et dignité? Voilà bien une question qui n'avait pas été aussi pertinente depuis bien longtemps. Destination privilégiée des jeunes cerveaux ambitieux, Wall Street, a perdu beaucoup de son lustre. Au milieu de cette grande confusion des idéaux et du naufrage de bien des aspirations professionnelles, peut-être verrons-nous réémerger la certitude tranquille que le travail productif est le véritable fondement de toute prospérité. Tout d'un coup, il semble qu'on n'accorde plus autant de prestige à toutes ces méta-activités qui consistent à spéculer sur l'excédent créé par le travail des autres, et qu'il devient de nouveau possible de nourrir une idée aussi simple que : "Je voudrais faire quelque chose d'utile".
Il est intéressant de noter qu'il appelle cela "un bon travail". Cette qualification va au delà de l'aspect politique marxisant. Pour Crawford, il est avant tout question de bien être de l'individu qui exerce l'activité. Il explique, par exemple, sa propre expérience d'électricien :
Le moment où, à la fin de mon travail, j'appuyais enfin sur l'interrupteur ("Et la lumière fut") était pour moi une source perpétuelle de satisfaction. J'avais là une preuve tangible de l'efficacité de mon intervention et de ma compétence. Les conséquences étaient visibles aux yeux de tous, et donc personne ne pouvait douter de ladite compétence. Sa valeur sociale était indéniable.
Et la satisfaction ne venait pas seulement de cette "valeur sociale", mais aussi (surtout?) la fierté du travail bien fait :
Ce qui ne m'empêchait pas de ressentir une certaine fierté chaque fois que je satisfaisais aux exigences esthétiques d'une installation bien faite. J'imaginais qu'un collègue électricien contemplerait un jour mon travail. Et même si ce n'était pas le cas, je ressentais une obligation envers moi-même. Ou plutôt, envers le travail lui-même – on dit parfois en effet que le savoir-faire artisanal repose sur le sens du travail bien fait, sans aucune considération annexe. Si ce type de satisfaction possède avant tout un caractère intrinsèque et intime, il n'en reste pas moins que ce qui se manifeste là, c'est une espèce de révélation, d'auto-affirmation. Comme l'écrit le philosophe Alexandre Kojève, "l'homme qui travaille reconnaît dans le Monde effectivement transformé par son travail sa propre œuvre : il s'y reconnaît soi-même, il y voit sa propre réalité humaine, il y découvre et y révèle aux autres la réalité objective de son humanité, de l'idée d'abord abstraite et purement subjective qu'il se fait de lui-même."2
Et c'est le lien entre cette idée subjective de soi même et la réalité objective du résultat produit qui fait qu'il y a des activités professionnelles qui peuvent être très épanouissantes. Le revers de la médaille est évidemment l'échec impossible à dissimuler, à différence des métiers non productifs, dont les résultats sont difficiles à mesurer quantitativement et même à évaluer qualitativement :
La vantardise est le propre de l'adolescent, qui est incapable d'imprimer sa marque au monde. Mais l'homme de métier est soumis au jugement infaillible de la réalité et ne peut pas noyer ses échecs ou ses lacunes sous un flot d'interprétations. L'orgueil du travail bien fait n'a pas grand-chose à voir avec la gratuité de l'"estime de soi" que les profs souhaitent parfois instiller à leurs élèves, comme par magie.
Crawford parle de "vantardise", ce qui peut-être compris comme étant moqueur dans cette citation hors de contexte. De mon point de vue, Crawford est très dur avec les activités qu'il appelle "fantomatiques" plus haut, mais il ne s'attaque jamais aux individus qui les exercent. Il y a dans le livre quelques pages sur les postes de management3 qui expliquent bien la difficulté d'occuper ce type de poste :
Pour commencer, Jackall4 observe que, malgré la nature essentiellement bureaucratique du procès de travail moderne, les managers ne vivent nullement leur rapport à l'autorité comme quelque chose d'impersonnel. Cette autorité est en fait incarnée dans les personnes concrètes avec lesquelles ils entrent en relation à tous les niveaux de la hiérarchie. La carrière d'un individu dépend entièrement de ses relations personnelles, entre autres parce que les critères d'évaluation sont très ambigus. Par conséquent, les managers doivent passer une bonne partie de leur temps à "gérer l'image que les autres se font d'eux". Soumis sans répit à l'exigence de faire leurs preuves, les managers vivent "dans une angoisse et une vulnérabilité perpétuelles, avec une conscience aiguë de la probabilité constante de bouleversements organisationnels susceptibles de faire capoter touts leurs projets et d'être fatals à leur carrière", comme l'écrit Craig Calhoun5 dans sa recension du livre de Jackall. Ils sont ainsi systématiquement confrontés à la "perspective d'un désastre plus ou moins arbitraire".
Malheureusement, et par le Principe de Peter, les individus techniquement compétents sont poussés à suivre des carrières qui les amènent à des postes où ils finissent par perdre tout contact avec la réalité concrète du travail et se retrouvent dans les situations décrites ci-dessus. Il reste encore des entreprises où l'excellence technique est reconnue comme une filière aussi importante que le management.
D'un autre côté, il faut bien reconnaître que dans les grosses structures il est nécessaire de gérer les équipes et que quelqu'un doit assurer une vision d'ensemble des activités, même si ce sont des tâches peu épanouissantes.
Footnotes:
Matthew B Crawford, Eloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, La Découverte, 2010, 249 p., EAN : 9782707160065.
Alexandre Kojève Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Paris, 1980, p.31-32
Le management ici a un sens trè général et non pas strictement hiérarchique. Par ailleurs, Crawford aborde la notion de hiérarchie basée sur une compétence technique, qu'il juge assez positivement.
R. Jackall, "Moral mazes : The world of corporate managers", Oxford University Press, 1988
C. Calhoun, "Why do bad careers happen to good managers?"
La dégradation du travail selon Crawford
Dans "Éloge du carburateur"1, M. Crawford explique que la distinction entre travail manuel et intellectuel est artificielle et relativement récente :
"L'émergence de la dichotomie entre travail manuel et travail intellectuel n'a rien de spontané. On peut au contraire estimer que le XXe siècle s'est caractérisé par des efforts délibérés pour séparer le faire du penser. Ces efforts ont largement été couronnés de succès dans le domaine de la vie économique, et c'est sans soute de succès qui explique la plausibilité de cette distinction. Mais dans ce cas, la notion même de "succès" est profondément perverse, car partout où cette séparation de la pensée et de la pratique a été mise en oeuvre, il s'en est suivi une dégradation du travail."
Il fait ensuite le constat que cette dichotomie a été étendue à des tâches qui étaient censées être purement intellectuelles, car le point important n'est pas tellement que le travail soit physique ou symbolique, mais plutôt que l'individu le réalisant ait de la latitude dans ses actions (agency) :
"Une bonne partie de la rhétorique futuriste qui sous-tend l'aspiration à en finir avec les cours de travaux manuels et à envoyer tout le monde à la fac repose sur l'hypothèse que nous sommes au seuil d'une économie postindustrielle au sein de laquelle les travailleurs ne manipuleront plus que des abstractions. Le problème, c'est que manipuler des abstractions n'est pas la même chose que penser. Les cols blancs sont eux aussi victimes de la routinisation et de la dégradation du contenu de leurs tâches, et ce en fonction d'un logique similaire à celle qui a commencé à affecter le travail manuel il y a un siècle. La part cognitive de ces tâches est "expropriée" par le management, systématisée sous forme de procédures abstraites, puis réinjectée dans le procès de travail pour être confiée à une nouvelle couche d'employés moins qualifiés que les professionnels qui les précédaient. Loin d'être en pleine expansion, le véritable travail intellectuel est en voie de concentration aux mains d'un élite de plus en plus restreinte. Cette évolution a des conséquences importantes du point de vue de l'orientation professionnelle des étudiants. Si ces derniers souhaitent pouvoir utiliser leur potentiel cérébral sur leur lieu de travail tout en n'ayant pas vocation à devenir des avocats vedettes, on devrait les aider à trouver des emplois qui, par leurs caractéristiques propres, échappent d'une façon ou d'une autre à la logique taylorienne."
La cause sous-jacente en serait donc l'optimisation recherchée par le taylorisme. La conséquence est donc la perte de la maîtrise, des compétences du métier. Et ceci est doublement dramatique, car la créativité n'est pas une qualité des esprits géniaux, mais plutôt le résultat de compétences capitalisées dans la durée :
"En réalité, bien entendu, la véritable créativité est le sous-produit d'un type de maîtrise qui ne s'obtient qu'au terme de longues années de pratique. C'est à travers la soumission aux exigences du métier qu'elle est atteinte (qu'on songe à un musicien pratiquant ses gammes ou à Einstein apprenant l'algèbre tensorielle). L'identification entre créativité et liberté est typique du nouveau capitalisme; dans cette culture, l'impératif de flexibilité exclut qu'on s'attarde sur une tâche spécifique suffisamment longtemps pour y acquérir une réelle compétence. Or, ce type de compétence est la condition non seulement de la créativité authentique, mais de l'indépendance dont jouit l'homme de métier."
On pourrait donc conclure que la logique économique pousse à la perte de compétences, qui elle entraîne le manque de créativité, la limitation de la liberté de l'individu dans son travail et enfin la frustration. Ceci est finalement assez cohérent avec ce qu'on entend souvent autour de la machine à café au boulot.
Mais ce serait trop simpliste d'oublier que souvent les individus eux-mêmes ont très envie de quitter des tâches techniques et concrètes. Parfois on dit que c'est la seule façon de faire carrière. Il doit y avoir aussi des cas où l'on essaye d'échapper à la réalité concrète des problèmes à résoudre :
"Dans toute discipline un peu ardue, qu'il s'agisse du jardinage, de l'ingénierie structurale ou de l'apprentissage du russe, l'individu doit se plier aux exigences d'objets qui ont leur propre façon d'être non négociable. Ce caractère "intraitable" n'est guère compatible avec l'ontologie du consumérisme, qui semble reposer sur une tout autre conception de la réalité."
Le désengagement vis-à-vis du travail concret est illustré par Crawford seulement sous l'aspect de l'aliénation par le découpage en sous-tâches simples et qui ne demandent pas de compétence particulière. Il y a un tout autre mode de désengagement qui mène au même résultat : la délégation, le faire faire au lieu de faire.
Souvent, les raisons de ce choix sont les mêmes que celles de la taylorisation : faire des économies (il est plus facile d'obtenir un budget one-shot que de dégager des RH). Ce qui est brillant dans le choix de la sous-traitance est qu'on n'a même pas besoin de faire de l'ingénierie de la connaissance pour automatiser le processus de production. Il suffit de passer un contrat. On peut même appliquer des pénalités au fournisseur en cas de délais2.
La grosse différence par rapport à la taylorisation est que ce n'est pas un ensemble d'individus incompétents qui travaillent à la chaîne pour accomplir la tâche, mais plutôt des clients de moins en moins compétents qui passent des contrats dont ils sont incapables d'évaluer les résultats. Mais cela tombe bien, puisqu'en face, les fournisseurs, jadis compétents et fiers, appliquent la même recette de façon transitive et ne se privent pas d'ajouter de la taylorisation dans la formule.
Si vous avez fait construire un joli pavillon avec jardin en banlieue, vous savez de quoi je parle. Si vous avez fait faire des travaux de rénovation, aussi. J'ai aussi entendu des anecdotes similaires dans des commandes auprès de graphistes, dans le développement informatique, dans la recherche scientifique. On en est tous un peu victimes et responsables à la fois.
Nous avons perdu la fierté d'avoir un métier et de bien le faire. Merci M. Taylor.
Allez, retournez à vos PPT et vos tableurs.
Footnotes:
Lingua Quintae Respublicae
"LQR : la propagande du quotidien"1 est le titre d'un livre d'Éric Hazan qui parle du développement d'une nouvelle langue à laquelle on est exposés en permanence (lisant le journal, écoutant les annonces dans le métro, le courrier en provenance de la Mairie) et "qui chaque jour efface les résistances, les différences, les opinions et travaille à la domestication des esprits". C'est la LQR, pour Lingua Quintae Respublicae.
Hazan explique comment ce langage est une propagande occulte. On pourrait s'attendre à une sorte de complot d'un petit nombre qui organiserait sa diffusion, mais ce n'est pas le cas. Pour Hazan, c'est le résultat d'une communauté de formation (ils sortent des mêmes écoles qui forment les élites de la nation) et d'intérêts des gens qui la forgent et qui la répandent.
Le livre n'est pas une étude scientifique, mais plutôt une liste d'exemples concrets interprétés par l'auteur. Il l'explique lui même ainsi :
N'étant ni linguiste ni philologue, je n'ai pas tenté de mener une étude scientifique de la LQR dans sa forme du XXIe siècle. Mais, le travail d'éditeur m'ayant fait entrer par la petite porte dans le domaine des mots, j'ai relevé dans ce que je lisais et entendais ici et là certaines expressions marquantes de la langue publique actuelle.
Il donne beaucoup d'exemples de substitution de mots par d'autres, en apparence synonymes, comme par exemple, l'utilisation de "problème" à la place de "question" (i.e. question sociale) :
A une question, les réponses possibles sont souvent multiples et contradictoires, alors qu'un problème, surtout posé en termes chiffrés, n'admet en général qu'une solution et une seule. La démonstration, toujours présentée comme objective, obéit à des règles déterminés par des spécialistes.
Aussi, l'utilisation d'anglicismes est analysée :
Dans l'évitement/substitution, le recours aux anglicismes est fréquent. C'est ainsi que préventif, sans doute trop clair, est lentement remplacé par préemptif : "L'idée d'une frappe préemptive [sur les installations nucléaires iraniennes] fait aujourd'hui l'objet d'intenses débats à Tel-Aviv" (Le Monde, 26 novembre 2004). Dans le même registre, la gouvernance a fait son entrée dans la LQR, prenant des parts de marché à gouvernement (trop étatique), à direction (trop disciplinaire), à management (trop technocratique, bien qu'assez ancien dans la novlangue).
Il analyse aussi la présentation de quelque chose comme acquis ou au contraire révolu, selon l'intérêt du moment :
Selon la vulgate néo-libérale, nous vivons dans une société post-industrielle. Faire disparaître l'industrie a bien des avantages : en renvoyant l'usine et les ouvriers dans le passé, on range du même coup les classes et leurs luttes dans le placard aux archaïsmes, on accrédite le mythe d'une immense classe moyenne solidaire et conviviale dont ceux qui se trouvent exclus ne peuvent être que des paresseux ou des clandestins.
Dans le même genre et sur la modernisation il nous propose :
Ce discours et à prendre au sérieux. Dans la stratégie de maintien de l'ordre, son but est double : faire croire que la modernisation est un processus mené dans l'intérêt de tous et qu'il n'y a ni raison ni moyen de s'y opposer; et masquer le fait inquiétant que, parmi l'"élite dirigeante", personne ne sait où l'on va.
Il donne aussi des exemples de mots qui disparaissent de la langue :
Le prolétariat est sorti du langage politico-médiatique par la même porte que la classe ouvrière : en appeler aux prolétaires de tous les pays passerait aujourd'hui pour une bouffée incontrôlée de nostalgie du goulag.
Ou des substitutions qui rendent impossibles certaines notions, car le mot substitut n'en permet pas l'usage :
Le remplacement des exploités par les exclus est une excellente opération pour les tenants de la pacification consensuelle, car il n'existe pas d'exclueurs identifiables qui seraient les équivalents modernes des exploiteurs du prolétariat.
Il y a aussi l'apparition de mots mous qui n'ont presque pas de contenu :
Mais malgré son affinité affichée pour le divers et le multiple, la langue des médias et des politiciens a une prédilection pour les mots qui sont au contraire les plus globalisants, immenses chapiteaux dressés sans le champ sémantique et sous lesquels on n'y voit rien. Je pense à totalitarisme, à fondamentalisme, à mondialisation, notions molaires comme disait Deleuze, propres à en imposer aux masses – par opposition aux outils moléculaires faits pour l'analyse et la compréhension.
Et des idées que l'on répète, à la limite de l'endoctrinement (et qui serait donc hérétique de questionner) :
La France pays des droits de l'Homme, la France terre d'accueil, ces expressions récurrentes n'ont été justifiées qu'à des moments historiques très courts : quelques mois pendant la Révolution, quelques semaines pendant la Commune de Paris - dont le ministre du travail était Leo Frankel, un ouvrier allemand, et qui avait confié à deux immigrés polonais la conduite de ses combattants. Le reste du temps – c'est à dire, en somme, presque tout le temps –, les étrangers ont été au mieux harcelés et au pire persécutés, le régime de Vichy et le pouvoir actuel étant allés jusqu'à punir sévèrement l'hébergement de ceux qui étaient/sont en situation "irrégulière".
L'objectif final de la LQR étant de dresser des écrans de fumée sur les sujets importants tout en faisant semblant de s'intéresser à la réalité des gens :
Ce fatras bien-pensant ne fait que confirmer les tendances de la démocratie libérale actuelle : retour à la bonne vieille morale, aux valeurs transcendantes et au sens du sacré, épandage éthique masquant les réalités financières, faux problèmes éthiquement montés en épingle pour éviter les questions gênantes. Un vaste territoire aménagé pour les âmes naïves, où experts, académiciens et autorités spirituelles s'expriment doctement sur le séquençage du génome humain, le transfert des joueurs de football, le traitement des déchets nucléaires ou l'enseignement du français.
En conclusion, un livre intéressant dont le seul point que j'ai trouvé gênant est celui de donner l'impression qu'il s'agit d'un phénomène qui n'existe qu'en France, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas.
Si vous faites partie des gens occupés qui n'ont pas le temps de lire, vous pouvez toujours écouter l'émission de D. Mermet dans laquelle Hazan avait participé lors de la sortie du livre.
Footnotes:
LQR : la propagande du quotidien, Liber-Raisons d'agir, 2006 (ISBN 2-912107-29-6)
Libre arbitre : la vidéo
On m'a fait découvrir cette vidéo sur le libre arbitre. Elle est très intéressante, car elle s'appuie sur des expériences de sciences cognitives qui ont tendance à prouver que ce qui est souvent appelé décision par les humains intervient bien après que les mécanismes neurologiques dans le cerveau se mettent en route pour exécuter les actions.
Les 3 points de vue sur la question sont bien présentés :
- Le déterminisme dur : le libre arbitre n'existe pas, car le cerveau obéit aux lois de la physique.
- Le dualisme : il existe une séparation entre corps et esprit qui n'obéissent pas aux mêmes lois.
- Le compatibilisme : même si tout est déterministe, c'est notre cerveau qui détermine nos actions et on appelle cela le libre arbitre.
Pour moi, ces 3 points de vue, peuvent être qualifiés (pas forcément dans l'ordre) de :
a) Scientifique. b) Désespéré. c) Magique.
A vous de relier les chiffres avec les lettres et de trouver la bonne réponse. Vous trouverez quelques indices ici, ici et ici.
Regardez la vidéo, elle vaut le détour. En tout cas, la conclusion permet de comprendre pourquoi on veut tellement y croire : si les gens arrêtaient de croire à l'existence du libre arbitre, les conséquences sociales seraient terribles!
Mais ne vous en faites pas, personne ne lit ça. Ils regardent un match à la télé ou sont sur Facebook.
#lelibrearbitrenexistepas
Ceci n'est pas un titre
Lors du dernier billet, j'ai essayé d'expliquer comment, à partir de théories mathématiques et d'analogies entre des modèles de calcul et des systèmes physiques, on peut légitimement mettre en question l'existence du libre arbitre. J'ai donnée quelques références vers des références qui expliquent tout cela bien mieux que ce que j'ai pu écrire.
Souvent, les gens qui se réclament des philosophies de type existentialiste ont beaucoup de mal à accepter ce genre de raisonnement, qui nie la possibilité de la liberté au sens classique. Ceci est complètement contradictoire avec la phrase de Sartre :
« il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté »1
La philosophie, comme la sociologie, étant un sport de combat, le débat avec les philosophes du libre arbitre se termine souvent par un commentaire du genre :
"S'il n'y a pas de libre arbitre, pourquoi essayes-tu de me convaincre? Si tu crois pouvoir me convaincre, cela veut dire que tu crois pouvoir me changer et que donc tout ne serait pas déterminé à l'avance."
Au delà du fait que cette argumentation peut être démontée facilement ("j'essaye de te convaincre parce que je suis déterminé ainsi", et vlan!), elle n'a aucun intérêt. Et c'est bien dommage, car je cherche désespérément quelqu'un qui pourrait me donner des éléments scientifiques qui démontrent l'existence de ce libre arbitre tant adoré.
Souvent, les arguments pour dire que le réductionnisme scientifique ne marche pas, sont basés sur le fait que le démon de Laplace date du début du XIXè siècle et que depuis on a développé la théorie du chaos qui démontrerait que Laplace avait tort. On sait que ce raisonnement confond les notions d'aléatoire et de prédictible et qu'il est donc faux.
Si avant la séparation entre science et philosophie (à partir de Galilée), on pouvait accepter que la philosophie était le savoir, depuis que la méthode scientifique a été formalisée, on ne devrait pas accepter comme possible ce qui n'est pas réfutable.
Il est paradoxal de constater que les philosophies athées font souvent appel à cette démarche pour défendre leurs positions (et c'est très bien!). Mais quand il s'agit de remettre en cause le libre arbitre, la machine déraille et la réaction de l'athée libertaire, libertarien, libéral ou libertin est de devenir dualiste et dire qu'il ne s'agit plus de processus physiologiques (donc physiques) mais de processus psychologiques et que donc, par conséquence, les lois de la physique ne s'appliquent plus. Pour moi, ceci relève de la pensée magique et s'éloigne de la science.
Il est vrai que je suis plutôt du côté de Rutherford :
"All science is either physics or stamp collecting"2
Il y a tout de même des philosophes qui s'intéressent à l'interface entre physique et biologie et ils ont l'air de le faire sérieusement. Mais cela reste de la physique (par opposition à la métaphysique). Ces travaux font référence à la notion d'autopoïèse qui elle est liée aux concepts évoqués lors de la présentation du Game of Life.
Je serais ravi de découvrir des approches scientifiques qui expliqueraient la dualité entre corps et âme, entre physiologie et psychologie, entre matériel et spirituel.
Et non, l'émergence ne compte pas, car le concept philosophique de "le tout est plus que la somme de ses parties" ne va pas bien loin et quand on fouille un peu dedans on se rend compte que cela reste explicable par les propriétés de la matière.
Il ne s'agit pas là d'une vision du monde qui manque de poésie, puisque nous sommes de la poussière d'étoiles! Malheureusement, il y a des allergiques à la poussière un peu partout.
Je comprends l'angoisse de l'existentialiste (à ne pas confondre avec l'angoisse existentielle) qui se rend compte de l'absence de libre arbitre, mais une fois qu'on a compris ça, ce serait de la mauvaise foi (de la vraie, et non pas celle de l'existentialisme) que de continuer à s'y opposer. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est alors peut-être un manque de compréhension de la notion d'auto-référence, avec laquelle on peut expliquer certains phénomènes d'émergence, le mécanisme de la conscience, etc.
Mais il est bien connu que la première chose qu'il faut faire pour comprendre l'auto-référence est de comprendre l'auto-référence! Et comme l'écrivait Kurt G. dans son journal intime un matin avant un départ en randonnée, "on n'est pas sortis de l'auberge"!
Footnotes:
Le jeu de la vie
C'est ainsi, Game of Life (GoL), qu'a été baptisé l'automate cellulaire imaginé par John Conway. Un automate cellulaire est un modèle où étant donné un état, on passe à l'état suivant en appliquant un ensemble de règles.
Dans le cas du GoL, le modèle est une grille (un quadrillage) composée de cellules qui sont, soit allumées (vivantes), soit éteintes (mortes). Les règles pour calculer l'état suivant sont simples1 :
- Une cellule morte possédant exactement trois voisines vivantes devient vivante (elle naît).
- Une cellule vivante possédant deux ou trois voisines vivantes le reste, sinon elle meurt.
En fonction de la taille de la grille et de la configuration initiale des cellules, l'évolution du jeu peut donner des résultats très intéressants. En voici un exemple tiré de Wikipédia :
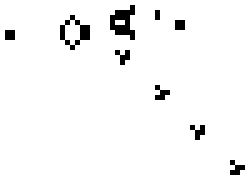
Au delà de son caractère amusant, le GoL présente des propriétés mathématiques très riches. Des structures stables et périodiques peuvent apparaître. Certaines ont même des noms très sympathiques : grenouilles, jardins d'Éden, etc.
Encore plus intéressant est le fait qu'il s'agit d'une machine de Turing universelle :
"il est possible de calculer tout algorithme pourvu que la grille soit suffisamment grande et les conditions initiales correctes"
et de là, il en découle, de par le problème de l'arrêt, qu'on ne peut pas prédire le comportement asymptotique de toute structure du jeu de la vie. Il s'agit d'un problème indécidable au sens algorithmique.
"Dire qu'un problème est indécidable ne veut pas dire que les questions posées sont insolubles mais seulement qu'il n'existe pas de méthode unique et bien définie, applicable d'une façon mécanique, pour répondre à toutes les questions, en nombre infini, rassemblées dans un même problème."2
On voit bien que, même une machine complètement déterministe et extrêmement simple, peut être imprédictible.
Il y en a qui seraient tentés de dire qu'une telle machine pourrait avoir du libre arbitre. Bien entendu, les gens sensés, auront un sourire narquois en entendant de tels propos. Une grille de morpion qui voudrait s'émanciper!
Si on revient sur le côté amusant du jeu, on pourrait avoir envie d'en faire un objet physique. Avec l'électronique bon marché pour les bricoleurs, il ne doit pas être difficile de brancher quelques (centaines de) LEDs et les piloter avec un Arduino contenant le programme avec les règles du GoL.
On pourrait même utiliser une webcam pour prendre une photo de l'environnement, la binariser et en faire ainsi la configuration initiale pour la grille.
De là, il est difficile d'échapper à la tentation du selfie pour initialiser le système. Est-ce que si on sourit sur la photo ça converge vers un jardin d'Éden3? Est-ce que si on fait la gueule ça génère des canons? Est-ce que si on prend Papi en photo ça nous fait des Mathusalems?
Et sans s'en rendre compte, on a construit un système physique qui réagit à l'expression d'un visage et dont l'état asymptotique est indécidable! C'est presque le niveau de développement social d'un bébé de quelques semaines. Et on peut le débrancher la nuit4!
Footnotes:
Comme d'habitude, Wikipédia est votre amie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_la_vie .
En fait, c'est impossible par définition, mais bon …
Ce n'est pas encore aussi abouti que ce que Charlotte proposait la semaine dernière, mais on s'en approche.
Les hommes occupés
Un commentaire à mon billet sur le travail disait :
"Le travail c'est la dignité de l'homme, oui. Parce que travailler c'est apporter à la communauté son œuvre, son intelligence dans le savoir-faire, ce qu'on appelle, ou qu'on appelait, l'”art”. Chacun est en possession d'un trésor personnel à donner à la société."
Je pense comprendre le sens du commentaire, mais je ne partage pas l'idée que la dignité de l'individu dépende du travail qu'il entreprend ou de sa contribution à la société. Qu'en est-il du chômeur, du chasseur-cueilleur, du retraité ?
Ce point de vue constitue un vrai problème dans nos sociétés supposées méritocratiques, où la valeur de l'individu est directement corrélée à sa réussite professionnelle. En fait, comme le dit Alain de Botton dans un TED Talk, on est dans une société de snobs :
Qu'est ce qu'un snob ? Un snob est une personne qui prend une petite partie de vous, et qui s'en sert pour établir une vision générale de qui vous êtes. Ceci est du snobisme.
Et le type de snobisme le plus commun qui existe aujourd'hui est le snobisme au niveau professionnel. On le rencontre après seulement quelques minutes à une fête, quand on vous pose cette célèbre question du 21e siècle, « Qu'est ce que vous faites ? » Et selon votre réponse à cette question, les gens sont soit heureux de vous rencontrer, ou ils regardent leurs montres et s'excusent.
L'opposé d'un snob c'est votre mère. Pas nécessairement votre mère, ni la mienne. Mais, en fait, la mère idéale. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas de vos accomplissements.
De Botton fait bien de préciser qu'il parle d'une mère idéale, car la plupart des mères1 sont tombées aussi dans le piège de l'anxiété de statut et élaborent des plans de carrière pour leurs rejetons dès leur plus tendre enfance, souvent sans prendre la peine de leur demander leur avis.
Cependant Alain de Botton a tort quand il dit qu'il s'agit d'un phénomène récent. En effet, pendant ma tentative de manger tout le paquet de madeleines, quand je terminais Sodome et Gomorrhe, j'ai trouvé ça :
"… On voit bien qu'il faut que vous n'ayez rien à faire", ajoutait-il en se frottant les mains. Sans doute parlait-il ainsi par mécontentement de ne pas être invité, et aussi à cause de la satisfaction qu'ont les "hommes occupés" – fût-ce par le travail le plus sot – "de ne pas avoir le temps" de faire ce que vous faites.
Certes il est légitime que l'homme qui rédige des rapports2, aligne des chiffres3, répond à des lettres d'affaires4, suit les cours de la Bourse5, éprouve quand il vous dit en ricanant : "C'est bon pour vous qui n'avez rien à faire", un agréable sentiment de supériorité. Mais celle-ci s'affirmerait tout aussi dédaigneuse, davantage même (car dîner en ville l'homme occupé le fait aussi), si votre divertissement était d'écrire Hamlet ou seulement de le lire. En quoi les hommes occupés manquent de réflexion. Car la culture désintéressée qui leur paraît comique passe-temps d'oisifs quand ils la surprennent au moment qu'on la pratique, ils devraient songer que c'est la même qui dans leur propre métier met hors de pair des hommes qui ne sont peut-être pas meilleurs magistrats ou administrateurs qu'eux, mais devant l'avancement rapide desquels ils s'inclinent en disant : "Il paraît que c'est un grand lettré, un individu tout à fait distingué".
Footnotes:
Qu'est-ce que le travail ?
Telle est la question que Russell se pose dans les premières pages de "Éloge de l'oisiveté"1. Il y répond à la manière d'un logicien, de façon concise, mais précise et complète :
Il existe deux types de travail : le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière se trouvant à la surface de la terre, ou dans le sol même ; le second, à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Le premier type de travail est désagréable et mal payé ; le second est agréable et très bien payé. Le second type de travail peut s'étendre de façon illimitée : il y a non seulement ceux qui donnent des ordres, mais aussi ceux qui donnent des conseils sur le genre d'ordres à donner. Normalement, deux sortes de conseils sont données simultanément par deux groupes organisés : c'est ce qu'on appelle la politique. Il n'est pas nécessaire pour accomplir ce type de travail de posséder des connaissances dans le domaine où l'on dispense des conseils : ce qu'il faut par contre, c'est maîtriser l'art de persuader par la parole et par l'écrit, c'est-à-dire l'art de la publicité.
Voilà en quelques lignes une critique, avec une bonne dose d'ironie, de l'absurdité du travail pour le travail, des théories politiques (marxistes ou capitalistes) sous-jacentes, de l'inutilité de certaines couches hiérarchiques qui rappelle le Principe de Peter.
Mais Russell nous aide aussi à comprendre ce qui pousse les humains à accepter ce jeu sans beaucoup de sens. Il le fait avec empathie pour les exploités manipulés (les pauvres dans ses termes) et les exploités passionnés (par exemple scientifiques et ingénieurs) :
Le fait est que l'activité qui consiste à déplacer de la matière, si elle est, jusqu'à un certain point, nécessaire à notre existence, n'est certainement pas l'une des fins de la vie humaine. Si c'était le cas, nous devrions penser que n'importe quel terrassier est supérieur à Shakespeare. Deux facteurs nous ont induits en erreur à cet égard. L'un, c'est qu'il faut bien faire en sorte que les pauvres soient contents de leur sort, ce qui a conduit les riches, durant des millénaires, à prêcher la dignité du travail, tout en prenant bien soin eux-mêmes de manquer à ce noble idéal. L'autre est le plaisir nouveau que procure la mécanique en nous permettant d'effectuer à la surface de la terre des transformations d'une étonnante ingéniosité.
Russell critique aussi le culte de l'efficacité qui nous mène à justifier une unique facette de l'activité économique générée par le travail :
Autrefois, les gens étaient capables d'une gaieté et d'un esprit ludique qui ont été plus ou moins inhibés par le culte de l'efficacité. L'homme moderne pense que toute activité doit servir à autre chose, qu'aucune activité ne doit être une fin en soi. Les gens sérieux, par exemple, condamnent continuellement l'habitude d'aller au cinéma, et nous disent que c'est une habitude qui pousse les jeunes au crime.
Par contre, tout le travail que demande la production cinématographique est respectable, parce qu'il génère des bénéfices financiers. L'idée que les activités désirables sont celles qui engendrent des profits a tout mis à l'envers. Le boucher, qui vous fournit en viande, et le boulanger, qui vous fournit en pain, sont dignes d'estime parce qu'ils gagnent de l'argent ; mais vous, quand vous savourez la nourriture qu'ils vous ont fournie, vous n'êtes que frivole, à moins que vous ne mangiez dans l'unique but de reprendre des forces avant de vous remettre au travail. De façon générale, on estime que gagner de l'argent, c'est bien, mais que le dépenser, c'est mal.
Pour actualiser ces propos2, on pourrait remplacer cinéma par jeux vidéo ou réseaux sociaux, mais la schizophrénie reste la même.
Bon, tout ça est très bien, mais vous avez déjà perdu pas mal de temps à lire ceci (et moi à l'écrire). Allez, au boulot !
Footnotes:
La première édition de Éloge de l'oisiveté a paru en 1932.
Chaos, hasard et libre arbitre
J'ai assisté hier à une conférence sur les fondements de la liberté pendant laquelle j'ai cru détecter une confusion – qui arrive souvent – entre chaos et non-déterminisme. Il a été malheureusement impossible de débattre du sujet, et je me suis senti frustré de ne pas pouvoir exposer clairement mes propos en quelques phrases, car je ne m'y étais pas préparé.
Comme ce n'est pas la première fois que j'échoue à expliquer pourquoi le chaos n'a rien d'aléatoire, j'ai décidé de rédiger un argumentaire auquel je pourrais me référer si la situation se présente à nouveau.
Je n'ai jamais vraiment manipulé le concept de chaos dans un cadre concret, mais cela m'a beaucoup intéressé à la suite de ma thèse ou j'ai travaillé sur la modélisation et l'inversion de systèmes non-linéaires. Les outils mathématiques développés dans l'étude des systèmes dynamiques non-linéaires permettent de modéliser le chaos.
Heureusement, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la physique et des mathématiques pour comprendre le chaos.
"La théorie du chaos - vers une nouvelle science" de James Gleick est une très bonne introduction pour les néophytes, mais un peu trop romancée à mon goût. Je préfère nettement "Dieu joue-t-il aux dés? - Les mathématiques du chaos" d'Ian Steward.
Comment définir le chaos simplement? Ian Steward dans la préface de la 2è édition de son livre le dit comme ceci :
On parle de chaos lorsqu'un système déterministe (c'est-à-dire non aléatoire) se comporte de manière apparemment aléatoire […].
Un système ou un phénomène chaotique est donc parfaitement déterministe, même s'il n'est pas prévisible. La non prévisibilité de son état futur vient de son extrême sensibilité aux changements, même minimes, sur son état présent. C'est ce que populairement on appelle "effet papillon" et qui rend extrêmement difficile la prévision météorologique, par exemple.
Il n'est donc pas étonnant que le vrai chaos dérange énormément ceux qui tiennent certaines positions philosophiques sur la liberté des individus. S'il n'y a pas de vrai phénomène aléatoire dans l'univers, et que tout est déterministe, les individus ne sont pas libres, mais parfaitement déterminés. La liberté ne serait qu'une illusion causée par la non prévisibilité du chaos. Ou comme le disait Spinoza, on se croit libres parce que l'on ignore les causes qui nous déterminent.
En effet, on peut raisonner comme cela au niveau macroscopique. En revanche, au niveau quantique, il pourrait ne pas en être ainsi. En effet, selon le principe de superposition, un système pourrait se trouver dans plusieurs états à la fois (le chat de Schrödinger). Et ceci n'est pas un état traduisant une ignorance vis-à-vis de l'état réel du système, mais bien une indétermination intrinsèque au système.
Cette interprétation a donnée lieu à beaucoup de polémiques, dont la plus connue est celle entre Einstein et Born, que Stewart rappelle dans le chapitre 16 intitulé "Le chaos et la mécanique quantique" :
Quand Einstein énonça sa remarque fameuse sur Dieu qui ne jouerait pas aux dés, il faisait allusion à la mécanique quantique. Celle-ci diffère par bien des points de la mécanique "classique" de Newton, Laplace et Poincaré sur laquelle la discussion a principalement porté jusque là. Einstein formula cette assertion devenue célèbre dans une lettre au physicien Max Born dont voici un plus ample extrait :
"Vous croyez en un Dieu qui joue aux dés et moi dans un ordre et des lois absolus régnant sur un monde qui existe objectivement et que j'essaie de saisir, même si c'est extrêmement spéculatif. J'y crois fermement, mais j'espère que quelqu'un le découvrira plus concrètement ou, au moins, d'une façon un peu plus tangible que tout ce à quoi j'ai abouti. Même les importants succès initiaux de la théorie quantique ne me font pas croire en un jeu de dés, fondamental, bien que je réalise parfaitement que vos collègues plus jeunes n'y voient là qu'un signe de sénilité"
On ne connaissait pas le chaos à l'époque d'Einstein, mais c'était là le genre de concept qu'il recherchait. Ironiquement, la représentation du hasard par un dé qui roule fait appel à la mécanique déterministe et classique, non quantique, et le chaos lui-même est un concept avant tout de mécanique classique.
Je ne soutiens pas que l'aléatoire n'existe pas, mais si je devais parier, je serais du côte d'Einstein.
Mais si nous supposons que le hasard quantique existe, le libre arbitre existe aussi. Ceci a été démontré par Conway et Kochen en 2006 à partir de l'hypothèse "spin". C'est le théorème du libre arbitre dont le corollaire est très bien résumé dans l'article de Wikipédia :
Cela ne signifie pas que le déterminisme soit faux, en effet si l'univers est entièrement déterministe, alors il n'y a pas de libre arbitre chez les humains et le théorème ne s'applique pas. Mais s'il existe un indéterminisme (un libre arbitre) chez les humains, il en existe aussi un pour les particules élémentaires.
En conséquence, tant que l'hypothèse "spin" n'est pas confirmée ou infirmée, croire dans la possibilité de liberté des individus est seulement une position philosophique. Et de toute façon, cette explication permet de ne pas angoisser trop :
Dans une de ses conférences consacrée au thème du voyage temporel, l'astronome Sean Carroll explique que le concept de libre arbitre n'est qu'une approximation et qu'il est en théorie tout à fait compatible avec le déterminisme. […]
"Beaucoup de gens sont perturbés par l'idée de déterminisme : cette idée selon laquelle si on connaît l'état exact de l'univers à un instant donné, on peut prédire le futur.
Je voudrais vous dire: ne soyez pas perturbés. Le déterminisme, ce n'est pas un vieil homme sage qui dirait: « Voici ce qui va se produire dans le futur et tu n'y peux absolument rien ». Ce n'est pas cela du tout.
L'idée de déterminisme c'est plutôt un garnement qui dirait: «Je sais ce que tu vas faire dans un instant». Alors vous lui demandez: «Admettons. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? » et il répond: «Ça je ne peux pas te le dire ». Puis vous faites quelque chose et le gamin s'exclame: « Je savais que tu ferais ça »."
Selon Caroll, le déterminisme n'est donc pas incompatible avec le libre arbitre puisqu'aussi longtemps que nous ignorons ce que nous ferons dans le futur, l'éventail des possibles reste au moins théoriquement réalisable, de telle sorte qu'un futur non-déterministe nous parait tout à fait équivalent.
Enfin, grâce à Dieu, je suis athée, parce comme le dit Stewart dans l'épilogue de son livre :
Si Dieu jouait aux dés … il gagnerait!
